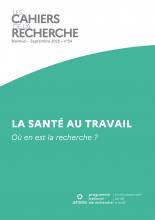Les cahiers de la recherche
Notre dernier numéro : Cahier de la recherche n°24 : LA SANTÉ AU TRAVAIL - Où en est la recherche ? (PDF)
Depuis sa création en 2012, la collection des Cahiers de la Recherche s’est attachée à valoriser les projets de recherche financés grâce au Programme National de Recherche Environnement-Santé-Travail (PNR EST). Chaque cahier thématique est conçu dans la perspective d’apporter un regard croisé sur la recherche, l’expertise et les préoccupations de la société sur des sujets à forts enjeux sanitaires. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle version de ces cahiers de la recherche, enrichie de nouvelles rubriques qui permettront d’approfondir les sujets et de mettre en lumière ce lien fort et nécessaire qu’entretient la recherche avec l’expertise et la décision publique.
La santé au travail est une thématique qui illustre parfaitement ce lien. Cette mission socle de l’Agence est d’autant plus importante que la transformation du monde du travail s’accélère. Alors que des risques « historiques », physiques et chimiques comme l’amiante en focus dans ce numéro, sont étudiés depuis de nombreuses années et restent toujours d’actualité, de « nouveaux » risques émergent, liés par exemple à l’exposition aux lumières LED ou encore aux pathogènes transmis par les tiques, qui se doivent d’être pris en compte et évalués. Le développement des technologies numériques a fait apparaitre de nouvelles formes de travail, de nouveaux métiers avec pour chacun ses contraintes spécifiques, engendrant souvent de nouvelles inégalités face à la santé au travail.
Chacun de nous est exposé à de multiples facteurs de risques - avérés comme potentiels - tout au long de sa vie, professionnelle et personnelle, ce qui rend complexe l’évaluation des risques et la mise en évidence de liens entre expositions et pathologies. Aussi, encourager et développer la recherche scientifique est aujourd’hui indispensable pour mieux comprendre les liens entre risques, conditions de travail et état de santé des travailleurs et, in fine, concevoir des mesures de prévention adaptées. Sur ce volet recherche, l’Anses est très impliquée puisqu’elle coordonne depuis près de vingt ans le Programme national de recherche environnement-santé-travail (PNR EST). Plus récemment, elle s’est également vu confier le pilotage de la réalisation d’un « livre blanc » pour une stratégie nationale de recherche en santé au travail, répondant à l’objectif 7 du plan Santé au Travail n°4 (2021-2025).
Dans le cadre du PNR EST, l’Anses finance chaque année des projets de recherche. Sur les 703 projets financés depuis 2006, près d’un tiers répond au besoin de connaissances dans le domaine de la santé au travail. Les résultats de ces projets sont cruciaux pour faire croître les connaissances et alimenter les travaux d’expertise de l’Anses.
Ce cahier présente une sélection de projets en santé travail récemment financés par le PNR EST qui illustrent les différents types d’exposition (chimique, physique, biologique et psychosociaux) et co-exposition professionnelles possibles. La publication de ce numéro accompagne la rencontre scientifique sur « Les (nouveaux) enjeux de la santé au travail » du 30 septembre 2025, organisée en partenariat avec la Dares pour présenter des résultats de projets de recherche de nos programmes respectifs.
Pr Benoit VALLET
Directeur général, Anses
Anciens numéros
- Cahier de la recherche n°23 : Les perturbateurs endocriniens - Comprendre où en est la recherche (PDF)
- Cahier de la recherche n°22 : "Cancer et environnement - Comprendre où en est la recherche" (PDF)
- Cahier de la recherche n°21 : "Air et santé - Comprendre où en est la recherche" (pdf)
- Cahier de la recherche n°20 : "Radiofréquences et santé" (pdf)
- Cahier de la recherche n°19 : "La santé au travail" (pdf)
- Cahier de la recherche n°18 : "L'exposition des enfants" (pdf)
- Cahier de la recherche n°17 : "Microplastiques et nanomatériaux" (pdf)
- Cahier de la recherche n°16 : "Les contaminants chimiques seuls ou en mélange" (pdf)
- Cahier de la recherche n°15 : "La lutte antivectorielle" (pdf)
- Cahier de la recherche n°14 : "Air et santé" (pdf)
- Cahier de la recherche n°13 : "Perturbateurs endocriniens"
- Cahier de la recherche n°12 : "Cancer et environnement" (pdf)
- Cahier de la recherche n°11 : "La santé au travail" (pdf)
- Cahier de la recherche n°10 : "Résistances et méthodes alternatives" (pdf)
- Cahier de la recherche n°9 : "Radiofréquences et santé" (pdf)
- Cahier de la recherche n°8 : "Regards sur 10 ans de recherche. Le PNR-EST, de 2006 à 2015" (pdf)
- Cahier de la recherche n°7 : "Santé et pollution atmosphérique" (pdf)
- Cahier de la recherche n°6 : "Nanomatériaux et santé" (pdf)
- Cahier de la recherche n°5 : "Cancers et environnement" (pdf)
- Cahier de la recherche n°4 : "Santé au travail" (pdf)
- Cahier de la recherche n°3 : "Les résistances aux insecticides, antiparasitaires, antibiotiques..." (pdf)
- Cahier de la recherche n°2 : "Risques sanitaires liés à la pollution des milieux aériens et hydriques" (pdf)
- Cahier de la recherche n°1 : "Les pertubateurs endocriniens en 12 projets," (pdf)